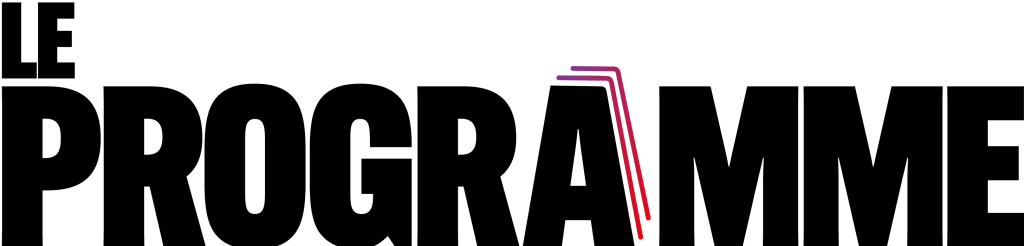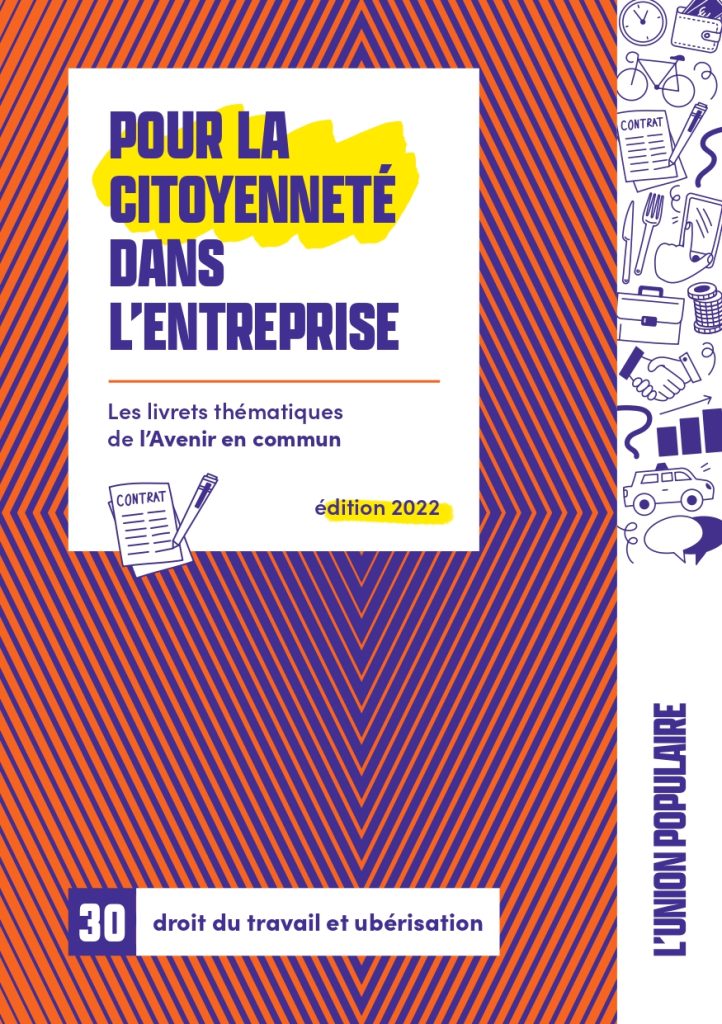Le droit du travail est une invention récente. En 2021, nous fêtions le 180e anniversaire de la première loi en la matière, interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans. Elle proclamait que la santé des enfants prime sur l’accumulation de profits. Cette intervention de l’État rompait alors avec le libéralisme, qui avait tant usé les corps et les esprits que les individus ne tenaient plus debout, mourraient au travail ou souffraient de maladies chroniques – bref, le capitalisme apparaissait comme un trouble sanitaire public !
Bien d’autres lois ont suivi, protégeant les salarié·es, les chômeur·ses, les indépendant·es, au gré des luttes sociales. Ces lois constituent un « droit du travail », qui introduit de l’intérêt général au sein des entreprises et sur le marché du travail. Il limite l’emprise des employeurs sur les employé·es. Ceux-ci ont des droits : s’exprimer, élire des représentant·es, se retirer d’une situation dangereuse, rester en bonne santé, s’instruire, se reposer. Ce sont des droits, c’est-à-dire qu’on peut les exercer sans devoir sans cesse négocier ou se battre. Ils fondent la citoyenneté dans l’entreprise.
Depuis, cette lente construction du droit du travail s’est opérée avec des avancées notables, correspondant en général à des périodes politiques favorables au mouvement ouvrier (1936, 1945, 1968, 1981…), des stagnations et de rares reculs (1939-1944) jusqu’à la fin du 20e siècle. Mais depuis, les présidences Sarkozy, Hollande et Macron ont multiplié les mauvais coups, afin de transformer les entreprises en zone de non-droit. L’impunité est totale pour les criminels, l’indifférence est totale pour les victimes. Il est temps de stopper cette dégradation des droits collectifs et individuels des travailleur·ses et de renouer avec une dynamique de progrès social.
Notre constat : la flexibilisation est au seul service des actionnaires
Au fil des « conquis sociaux » du siècle passé, le droit du travail avait consacré le « principe de faveur » : une norme inférieure ne pouvait qu’améliorer la norme supérieure. L’accord d’entreprise devait être au moins aussi favorable que l’accord de branche, lui-même au moins aussi favorable que la loi. Ainsi, les salarié·es ne se faisaient jamais concurrence par le bas mais tentaient d’accéder à de nouveaux droits ensuite étendus aux autres. Ce fondement du droit social a été liquidé brutalement et le dumping social réhabilité. Désormais, en principe, un accord d’entreprise prime sur une convention de branche même s’il lui est moins favorable, et le nombre de dérogations possibles au Code du travail a explosé ! Une entreprise peut supprimer une prime d’ancienneté ou de 13e mois pourtant prévue par la convention collective. Et alors que le Code du travail fixe une durée maximale de 18 mois pour un CDD, un accord de branche peut désormais augmenter cette durée sans aucun plafond sur plusieurs années.
Dans ce nouveau cadre, la feuille de route du Medef a été suivie à la lettre par les gouvernements successifs, au nom de la « compétitivité » et de la lutte contre le chômage. Celle-ci nécessiterait de remettre en cause des protections des salarié·es au motif que le manque de flexibilité et le prix du travail empêcheraient les employeurs d’embaucher. L’intérêt des salarié·es a totalement disparu des débats sur le Code du travail.
Pourtant, le Code du travail n’y est pour rien dans la situation de l’emploi, en dépit de la propagande médiatique. Plusieurs études prouvent qu’il n’y a aucune corrélation entre diminution des droits des salarié·es et baisse du chômage. C’est avant tout le carnet de commandes, et non l’état du droit du travail, qui dicte la politique d’embauches d’une entreprise.
Accuser le droit du travail d’être un frein à l’emploi, cela revient à accuser celles et ceux qui sont en emploi et qui bénéficient des protections données par le Code du travail d’être responsables de l’augmentation du chômage. Comme s’il y avait deux camps face à face : celles et ceux qui se situent « au dedans », qui disposent d’un CDI, et celles et ceux qui sont « au dehors », enchaînant les contrats précaires et les périodes d’inactivité. Ces analyses cherchent à opposer les salarié·es entre elles et eux. Elles oublient surtout le rôle des employeurs et des actionnaires dans la gestion de l’emploi en France : ce sont eux qui décident de l’allocation des bénéfices, du niveau d’investissements et donc des recrutements ! Surtout en 2022, alors qu’une petite poignée de grands groupes tient le capitalisme français et qu’un millième des entreprises embauche près de la moitié du salariat.
Des conditions de travail dégradées pour augmenter les dividendes, ça suffit ! Cette politique n’a qu’un intérêt en réalité : accroître la ponction que les actionnaires réalisent sur le travail en obligeant les salarié·es à accepter des baisses de salaires, des hausses du temps de travail sans contrepartie, des dégradations de leurs conditions de travail, sous la menace des licenciements. Cela fonctionne : la France est devenue championne d’Europe des dividendes. En 2021, plus de 60 milliards d’euros ont ainsi été distribués par les entreprises à leurs actionnaires, sans parler des 24 milliards d’euros donnés en rachat d’action. Si démanteler le Code du travail a bien enrichi ces derniers, cela a aussi amené la stagnation de la productivité du travail, car les salarié·es sont en insécurité, perdent le sens de leur travail et ne peuvent pas mener des projets sur le long terme.
Près de 40 % des salarié·es ont moins de 5 ans d’ancienneté en poste (INSEE)
À cause de cette politique, les salarié·es souffrent davantage au travail et ont moins de temps libre. La frontière entre la vie privée et la vie professionnelle disparaît peu à peu. Les maladies professionnelles, les burn-out et les suicides sur le lieu de travail se multiplient. Plus généralement, des millions de personnes s’échinent à donner le meilleur d’elles-mêmes, sans jamais être reconnues, sans jamais pouvoir s’exprimer sur l’organisation du travail, sans jamais être fières du produit fini.
Il n’y a aucune fatalité à cela. Cette situation est choisie par des gouvernements qui privilégient l’intérêt des actionnaires et adoptent des théories archaïques, alors que démocratiser l’entreprise est un impératif pour travailler mieux et élever les qualifications du peuple.
Notre projet : étendre les droits
La mise en avant du « dialogue social » par le gouvernement n’a été que le prétexte pour légitimer et accroître le pouvoir patronal. En face-à-face, l’employeur a toujours plus de pouvoir que le salarié. Le capitalisme contemporain imite de plus en plus le monde féodal, avec ses suzerains et ses serfs, abandonnant tout espace de dialogue, de négociation et de contestation. C’est le retour de la domination absolue qui provoque toujours des erreurs stratégiques, des investissements erronés et des choix coûteux.
En effet, la nature du comité d’entreprise (CE) a été bouleversée. À l’origine, le CE est une instance chargée du contrôle de la marche générale de l’entreprise, un contrepoids au pouvoir de décision unilatéral de l’employeur·euse. Le gouvernement l’a transformé en un comité social et économique (CSE) qui s’apparente à une courroie de transmission auprès des salarié·es de la vision qu’ont de l’entreprise ses actionnaires. Il a utilisé dans ce but la promotion d’une hypothétique démocratie sociale, dont il a liquidé dans le même mouvement une grande partie des fondements et des moyens.
C’est tout l’inverse qu’il convient de faire en étendant les droits des salarié·es et en abrogeant l’ensemble des réformes du Code du travail mises en œuvre sous les quinquennats Hollande et Macron (loi dite de Sécurisation de l’Emploi, loi Rebsamen, loi Macron, loi El Khomri, ordonnances Macron). La mondialisation et le développement de la financiarisation de l’économie ne justifient pas une réduction des droits au nom de la compétitivité, mais bien au contraire leur extension, afin d’élever l’intelligence collective et la capacité à développer de nouveaux processus de production, tout en protégeant les salarié·es contre les fonds de pension internationaux ou les actionnaires cupides.
Dans le même temps, les frontières de l’emploi sont elles-mêmes attaquées. En se faisant passer pour de simples intermédiaires, les plateformes numériques s’attachent les services de travailleur·ses soi-disant indépendant·es mais en réalité subordonné·es, leur évitant d’assumer leurs responsabilités d’employeur. Les travailleur·ses, souvent des coursier·es à vélo ou des conducteur·ices VTC, sont donc exclu·es du droit du travail… et ne bénéficient d’aucun des avantages de l’indépendance puisqu’ils ne choisissent ni leurs horaires, ni le prix de leur service !
Il est donc urgent de reconstruire le salariat, c’est-à-dire partir des droits pour habiliter les salarié·es à négocier pour le mieux les conditions concrètes du travail. De cette manière, nous remoraliserons le marché de l’emploi et le monde du travail, mettant fin aux pratiques barbares que l’on constate encore couramment, à l’instar de cette caissière d’Auchan poussée à faire une fausse couche sur son poste de travail, ou cette factrice de la Poste forcée de continuer à travailler après un AVC. Qui parle de droits parle de garanties, et donc d’institutions de contrôle auxquelles conférer les moyens nécessaires.
Ainsi, le Code du travail doit devenir un outil d’émancipation des salarié·es en donnant la possibilité à leurs représentant·es de porter des alternatives à la gestion financière et court-termiste de leurs entreprises.
Nos propositions : vers le travail du XXIe siècle
L’urgence : interdire les licenciements abusifs
Des vies sont brisées pour satisfaire les actionnaires par des licenciements boursiers qui suppriment des emplois alors que l’entreprise ne connaît aucune difficulté financière réelle, à la seule fin d’accroître les profits de court-terme.
- Interdire les licenciements économiques lorsque l’entreprise fait des bénéfices ou que son niveau de trésorerie, d’endettement et d’autofinancement ne remet pas en cause sa viabilité
La finance contre l’emploi
Les licenciements boursiers sont mis en lumière avec l’affaire Michelin en 1999 : la société affiche des bénéfices semestriels en augmentation de 17 % tout en procédant à la suppression de 7 500 emplois en Europe. En 2009, c’est au tour du groupe Total Fina Elf d’annoncer un bénéfice de 14 milliards d’euros et 555 suppressions de postes. Depuis, la financiarisation de l’économie perdurant, ces cas extraordinaires deviennent la norme. Schneider Electric, Altice, Nokia, Danone, Sanofi ou Total ont tous récemment supprimé des emplois pour augmenter leur cours en bourse, alors que les profits sont là.
D’autant qu’Emmanuel Macron a ouvertement encouragé les licenciements boursiers. Depuis ses ordonnances de 2017, un licenciement économique n’est plus évalué à l’échelle mondiale – le groupe va-t-il bien ? – mais à la seule échelle nationale – le groupe en France va-t-il bien ?. C’est la fin de la socialisation des profits entre sites : il suffit de déséquilibrer un peu la chaîne de valeurs et tous les groupes transnationaux pourront fermer impunément leurs établissements.
Le président de la République a même nommé une licencieuse boursière, Muriel Pénicaud, au ministère du Travail. Rappelons qu’elle avait profité d’un plan de licenciement chez Danone, alors au maximum de ses profits, pour empocher en une seule journée 1,13 million d’euros via une revente d’actions !
Et si les tribunaux donnent parfois raison aux salarié·es, il est toujours trop tard. Certes, les salariés de l’usine Continental à Clairoix, Molex de Villemur-sur-Tarn ou Metaleurop à Noyelles-Godault ont obtenu la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle ni justifiée : l’usine générait des bénéfices, était rentable, et n’avait été fermée que pour complaire aux actionnaires. Mais à chaque fois, la décision a été rendue cinq, sept et huit ans après les faits ! Plutôt que de condamner a posteriori, il faut intervenir en amont et interdire ces pratiques
L’impunité des licencieurs doit aussi prendre fin :
- Abroger le « barème Macron-Pénicaud » qui plafonne les indemnités dues aux salarié·es en cas de licenciement abusif, pour accorder une indemnité fixée en fonction du préjudice subi, doublée d’une pénalité forfaitaire versée à l’assurance-chômage
- Donner aux comités d’entreprise le droit de saisine du Conseil des prud’hommes en référé contre une mesure de licenciement
- Allonger les délais de prescription pour l’ensemble des recours devant le Conseil de prud’hommes à cinq ans (contre un à trois aujourd’hui)
Pour un nouveau salariat : protéger et sécuriser
La logique de moins disant social prendra fin lorsque nous rétablirons une hiérarchie des normes :
- Imposer qu’un accord de branche soit au moins aussi favorable que la loi, et qu’un accord d’entreprise soit au moins aussi favorable qu’un accord de branche
- Étendre systématiquement les accords de branches à l’ensemble des salarié·es du secteur
Mais tout ne se négocie pas. Le droit à vivre en toute sécurité n’est pas une option :
- Assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail (droit à la formation, ancienneté, etc.)
- Encadrer le recours aux contrats précaires par les entreprises : pas plus de 10 % dans les PME, pas plus de 5 % dans les grandes entreprises, y compris les contrats de mission, désormais subordonnés à un accord de branche
- Rétablir les 35 heures hebdomadaires : les heures au-delà seront surpayées à 25 % pour les quatre premières et 50 % au-delà. Les métiers pénibles ou de nuit passeront immédiatement aux 32 heures, puis nous enclencherons une négociation interprofessionnelle nationale pour élargir cette réduction du temps de travail
- Instituer une sixième semaine de congés payés
- Abroger les dérogations assouplissant le travail dominical. Nous les remplacerons par une procédure dérogatoire standard sous contrôle de l’inspection du travail
- Appliquer la prime de précarité aux CDD d’usage ou « extras »
En trente ans, le taux de contrats précaires a triplé !
Il est impératif d’encadrer le télétravail pour en faire une modalité d’activité rationnelle et économe en énergie humaine, pas une stratégie d’exploitation accrue :
- Créer un véritable droit à la déconnexion, en interdisant de solliciter professionnellement un·e salarié·e hors de ses horaires de travail, sur le modèle portugais
- Exiger que l’employeur fournisse le matériel nécessaire au télétravail (ordinateur par exemple) et indemnise les frais d’utilisation professionnelle de l’équipement personnel du foyer (connexion internet, chauffage…) soit au réel, soit par une indemnité forfaitaire justifiée et proportionnée d’au moins 5 € par jour
Notre vision du monde du travail tient en une expression : à travail égal, salaire égal
- Créer dans toutes les entreprises une commission de contrôle salarié sur l’égalité entre les femmes et les hommes auprès de laquelle l’employeur devra prouver son respect de l’égalité salariale
- Faire verser une prime d’égalité salariale de 10 % à toutes les femmes par les entreprises incapables de prouver le respect de l’égalité de traitement
- Augmenter les sanctions financières et pénales à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale (amendes et refus d’attribution de marchés publics)
- Réinstituer les commissions administratives paritaires pour la fonction publique
- Interdire le détachement de salarié·es ayant signé un contrat de travail dans un autre pays et s’acquittant du taux de cotisations sociales de ce même pays. C’est un véritable dumping social à domicile
En outre, ces dix dernières années ont vu l’explosion du recours à la sous-traitance : gardiennage, accueil, nettoyage, travaux publics… La division des tâches permet aux employeurs de se dédouaner de toute responsabilité quant aux conditions de travail. Cela est renforcé par le fait que certains grands groupes contrôlent de fond en comble des secteurs d’activité entiers. En sous-traitant une partie de leurs effectifs, ils contournent ainsi leurs obligations en termes de représentation des salarié·es – comme face aux femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles, parfois en poste depuis plus de 15 ans sans être reconnues salariées par l’établissement et subissant des cadences insoutenables de la part du donneur d’ordre ! Cela cessera :
- Limiter la sous-traitance à un seul niveau
- Justifier son recours par l’incapacité technique du donneur d’ordre de réaliser les tâches en interne
- Garantir la présence de délégués de proximité représentant les salarié·es sous-traité·es sur leur lieu de travail et auprès du donneur d’ordre
Pour de nouvelles entreprises : la démocratie au travail
Depuis 1946, notre Constitution proclame que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Ce droit constitutionnel à la gestion démocratique des entreprises proclamé par le Conseil National de la Résistance n’a pourtant jamais réellement été mis en œuvre. Le patron, le dirigeant, l’actionnaire, est resté monarque absolu, décidant sans l’avis de ses salarié·es de l’organisation du travail, des plans de licenciement, et des niveaux de rémunération.
Nous entendons mettre fin à cet Ancien Régime de l’entreprise, en permettant aux salarié·es de passer du statut de simples sujets passifs à celui de citoyens et citoyennes actif·ves, participant aux décisions stratégiques et à la gestion quotidienne de l’entreprise. Nous entendons ainsi faire reconnaître l’entreprise comme un collectif de travail s’inscrivant dans un objectif d’intérêt général, aussi bien pour les travailleur·ses que pour l’ensemble de la société humaine et de l’écosystème, qui n’aura plus pour unique objet de produire sans conscience ou d’enrichir sans fin ses dirigeants.
Pour cela, nous attribuerons une réelle légitimité démocratique et un pouvoir de gestion et de décision aux institutions représentatives du personnel et aux représentant·es syndicaux :
- Donner aux représentant·es des salarié·es au moins un tiers et jusqu’à la moitié des droits de vote dans les conseils de direction des entreprises face aux actionnaires, afin qu’ils et elles puissent accéder aux informations, notamment comptables, et aux décisions stratégiques ou s’opposer à des décisions dangereuses
- Doter les élu·es du CSE d’un droit de veto suspensif sur les mesures de gestion prises par l’employeur (restructurations, licenciements…). Ils et elles pourront provoquer un vote de défiance des salarié·es à l’égard des dirigeants d’entreprise ou des projets stratégiques. L’ensemble des frais engagés pour mener à bien leurs missions seront pris en charge par l’entreprise
- Rétablir les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), leur attribuer un droit de veto sur les décisions contraires à la santé et à la sécurité des salarié·es et leur permettre d’ordonner le retrait immédiat des salarié·es exposé·es à des dangers graves et imminents
- En cas d’absence de représentant·es élu·es dans l’entreprise (très petites entreprises ou absence de candidat·es), élire des délégué·es au niveau du département sur liste syndicale qui pourront se rendre dans ces entreprises pour y vérifier l’application des droits des salarié·es
- Imposer la création de CSE communs entre établissements partageant une même direction de fait ou de droit pour éviter la fraude aux seuils sociaux (les entreprises qui divisent leurs sites ou leurs activités pour rester en-dessous d’un certain nombre de salarié·es et donc éviter d’avoir des interlocuteur·ices issu·es de syndicats, comme McDonalds)
- Abroger la loi du 6 août 2019 qui remet en cause le modèle français de fonction publique en limitant les droits des fonctionnaires. Rétablir et augmenter les compétences des commissions administratives paritaires sur l’avancement, la mobilité, l’égalité professionnelle et les rémunérations
- Afin de permettre aux travailleur·ses de gérer eux-mêmes leur entreprise, établir un droit général de préemption des salarié·es pour transformer l’établissement en difficulté en coopérative. Cette voie vers la généralisation de l’économie sociale et solidaire est traitée dans un livret spécifique
Protéger les travailleur·ses de l’ubérisation
La fraude à l’auto-entrepreneuriat et le travail ubérisé via une plateforme numérique sont un cheval de Troie du libéralisme qui vise à détricoter, à terme, l’ensemble des protections du Code du travail. Tout cela a démarré en 2008 avec l’invention par Sarkozy du statut d’auto-entrepreneur (aujourd’hui micro-entrepreneur) censé permettre l’exercice légal d’une activité accessoire ou complémentaire, générant peu de revenus et distincte du salariat. De nombreuses personnes y ont cru avant de sombrer dans la pauvreté. La moitié des micro-entrepreneurs gagnent moins de 330 euros par mois ! En fait, il s’agit souvent de salariat déguisé, les employeurs obligeant des travailleur·ses – parfois leurs propres salarié·es – à se déclarer en auto-entrepreneur pour « collaborer » sans aucune protection sociale.
Ce travail de démolition est passé à l’échelle supérieur avec les plateformes numériques, qui organisent le travail à l’aide d’un algorithme de distribution des tâches, de fixation du tarif et de sanction des travailleur·ses. Le contremaître est maintenant numérique. Le gouvernement a chouchouté les plateformes en leur taillant un statut sur mesure entre indépendant et salarié, puisque les salari·es des plateformes vont élire des représentants pour négocier avec les plateformes sans être salarié·es. Les plateformes se frottent les mains : elles pourront continuer à employer illégalement des faux indépendants simplement en leur accordant des miettes de protection sociale lors de négociations déséquilibrées. Cessons de câliner ces plateformes qui refusent tout compromis : il est temps d’appliquer le droit du travail et les conventions collectives des secteurs d’activités concernés, en vertu desquelles Uber n’est pas une plateforme de service mais une entreprise de transport ! Cette mesure est aussi une question d’équité vis-à-vis des concurrents qui respectent la loi et se font sabrer leur chiffre d’affaires de manière déloyale. On voit déjà la contamination, dans le secteur de la restauration, de la coiffure, des courses… où de pseudo-indépendant·es payé·es au lance-pierre remplacent les postes de travail existants. En pleine période de pénurie de soignants, une startup met même en relation infirmier·es et aide-soignant·es « autoentrepreneurs » avec des établissements de santé, dont les hôpitaux publics !
En outre, la loi est déjà là : l’utilisation du statut de travailleur.se indépendant par les plateformes numériques alors qu’elles exercent un lien de subordination sur les travailleur·ses est illégale ! De la Cour de Cassation française (mars 2020) à la Cour d’appel de Paris (septembre 2021), les juridictions requalifient la relation en contrat de travail. En mars 2022 encore, Deliveroo et trois de ses anciens dirigeants ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, en mars 2022, pour répondre de « travail dissimulé » à la suite d’un rapport de l’inspection du travail qui constatait que la plateforme avait eu recours, entre 2015 et 2017, « à des milliers de travailleurs sous un prétendu statut indépendant via des contrats commerciaux, alors que ceux-ci étaient placés dans un lien de subordination juridique permanente à son égard ».
Grâce au travail acharné de l’eurodéputée insoumise Leïla Chaibi, même la Commission européenne a établi dans une proposition de directive une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes dès lors que la plateforme exerce un contrôle sur le travailleur, caractérisé par critères spécifiés dans la directive. Le gouvernement cherche à freiner ce texte : selon Contexte, « la France veut donner priorité à la transparence des algorithmes, lors des négociations à venir lors de la PFUE sur la directive sur les travailleurs des plateformes… quitte à laisser traîner la partie sur la présomption de salariat » et « a des ambitions réduites sur le texte ».
Plutôt que d’attendre que chaque salarié se pourvoie en justice, réformons tout ce système immédiatement :
- Établir la présomption légale de salariat pour tou·tes les travailleur·ses de plateformes et auto-entrepreneurs en situation de forte dépendance économique avec un donneur d’ordre : à ce dernier de prouver l’absence de relation salariale
- Renforcer les droits des vrai·es travailleur·ses indépendant·es, en garantissant leur accès à la négociation collective
- Donner aux travailleur·ses des plateformes un droit de contestation et de révision des systèmes algorithmiques qui organisent leur activité. Ceux-ci seront accessibles et communiqués à l’inspection du travail, mettant fin au management occulte
- Interdire la création de dark kitchens (cuisines fantômes), ces faux restaurants souvent propriété de grands groupes financiers où l’on se contente de cuisiner pour les plateformes en arnaquant la clientèle convaincue de recourir à la restauration
- Contraindre les plateformes à partager sous forme open source leurs données liées au mobilités, comme le font déjà les transports publics. Ces données seront intégrées au Point d’Accès National aux données de transport, afin de rassembler, rendre disponible et valoriser les données de toute l’offre de mobilité au bénéfice des voyageur·ses
- Afin de changer de modèle, créer un organisme administratif chargé d’accompagner les travailleur·ses désireux·ses de s’auto-organiser en coopérative, pour récupérer l’outil de travail débarrassé de la rente que ponctionnent les propriétaires du logiciel
- Co-financer la création de plateformes numériques d’intérêt général, afin d’aider à leur construction et leur développement, et encourager les collectivités territoriales à faire de même, tout en s’assurant que les travailleur·ses détiennent 51 % des parts de la société
- Construire des plateformes numériques publiques permettant de simplifier et de fluidifier la mise en relation d’usager·es et travailleur·ses, tant pour des services matériels qu’immatériels. Ainsi, la valeur créée par cet écosystème sera reversée à la société et ne servira pas des intérêts financiers, en évitant ainsi de contribuer à la fraude fiscale et sociale
- Encourager les plateformes numériques d’intérêt général et les plateformes numériques d’intérêt public à prendre appui sur le logiciel de plateforme à code ouvert CoopCycle lors de la création d’une coopérative
Les conditions du changement : renforcer l’inspection et la justice du travail
L’inspection du travail, chargée de contrôler l’application effective des droits des travailleur·ses, est aujourd’hui en danger : parce qu’elle bloque les pires effets des politiques libérales, le gouvernement et le Medef veulent sa tête.
Les réductions d’effectif ont été massives : en 10 ans, moins 20 % d’agent·es de contrôle sur le terrain et moins 40 % d’agent·es de renseignement des usager·es ! Aujourd’hui près de 15 % des sections d’inspection sont vacantes et n’ont donc plus personne pour contrôler les entreprises. L’impunité est voulue.
En parallèle, les ministres du travail Muriel Pénicaud et Élisabeth Borne ont multiplié les entraves envers les agent·es qui persistent à protéger les salarié·es. Anthony Smith, inspecteur dans la Marne, a ainsi été sanctionné par sa ministre de tutelle… car il exigeait d’un employeur qu’il fournisse des masques au personnel ! Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer les moyens d’action de l’inspection du travail et de les protéger contre les entraves du Gouvernement pour garantir l’application du Code du travail. Nous proposons de :
- Doubler les effectifs de l’inspection du travail et inscrire dans la Loi un seuil minimum de 1 inspecteur·ice pour 500 entreprises (contre 1 pour 1000 entreprises aujourd’hui)
- Leur attribuer un pouvoir général d’arrêts de travaux et de retrait de salarié·es dans toutes les situations de danger grave et imminent pour leur santé et leur sécurité (par exemple en cas d’absence de mesures de prévention face au Covid)
- Protéger les inspecteur·ices des pressions et entraves du gouvernement, de sa hiérarchie ministérielle et préfectorale, via un statut indépendant
- Créer un pouvoir général de référé judiciaire concernant toute situation urgente, grave et manifestement illégale, portant notamment sur les droits fondamentaux, la santé et la sécurité au travail : l’inspecteur·ice du travail pourra demander à un juge de faire cesser ces situations en urgence
- Rétablir l’autorisation préalable obligatoire de l’inspection du travail pour pouvoir affecter des mineur·es à des travaux dangereux (exposition à des produits chimiques mortels, travaux en hauteur…), supprimée par François Hollande
- Donner le pouvoir d’infliger immédiatement des amendes forfaitaires lors d’un constat d’infractions contraventionnelles en entreprise (dépassement de la durée maximale du travail, non-respect du SMIC ou de la majoration des heures supplémentaires…), comme le fait la police sur la route par exemple
- Créer une inspection du travail adaptée à la fonction publique, chargée de garantir en toute indépendance le statut et les droits des fonctionnaires
Pour que les atteintes aux droits des salarié·es puissent être réellement poursuivies et condamnées, la justice du travail sera elle aussi renforcée :
- Créer un parquet spécialisé dans le droit pénal du travail et la fraude des entreprises dans le ressort de chaque Tribunal Judiciaire
- Doubler les effectifs dans les conseils de prud’hommes (greffiers…), pour ramener les délais de jugement à un objectif de 6 mois maximum (contre plus du double aujourd’hui)
- Rendre les amendes proportionnelles au chiffre d’affaires des entreprises
Ne pas perdre sa vie à la gagner !
Il faut renforcer les outils juridiques et remettre sur pied les institutions créées pour protéger la santé des salarié·es au travail : médecine du travail, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), inspection du travail, Institut national de la recherche et de la sécurité (INRS), représentant·es du personnel, justice … L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur vis-à-vis des salarié·es doit être inscrite dans le code du travail en lien avec des prescriptions claires et précises définies par la loi et sanctionnables pénalement. Le non-respect répété ou grave de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail exposera l’entreprise à une fermeture administrative, ainsi qu’à une pénalité financière sous forme d’augmentation automatique du taux de cotisation accident du travail/maladie professionnelle (en plus des sanctions administratives et pénales déjà existantes).
La reprise en main de l’organisation du travail par les salarié·es est aussi une nécessité pour retrouver du sens au travail et préserver sa santé, notamment contre les risques psychosociaux. Il faut souligner que l’article 8 du préambule de la Constitution de 1946 donne une valeur constitutionnelle au droit de tout·e travailleur·se à participer « par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail …».
Pourtant, les ordonnances Macron ont supprimé le CHSCT alors que les salarié·es, notamment dans le bâtiment et la chimie, s’appuyaient fortement sur cette instance autonome pour mettre en lumière les problèmes d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans leur entreprise. Nous le rétablirons dans le secteur privé et dans la fonction publique en augmentant leurs moyens, en élargissant leurs prérogatives aux questions écologiques et en rendant leurs avis contraignants. Les CHSCT disposeront d’un droit de veto contre les décisions qu’ils jugeront contraires à la préservation de la santé/sécurité des salarié·es. Ils pourront imposer la mise en place de mesures de sécurité et retirer un·e salarié·e de toute situation de danger grave et imminent.
La médecine du travail sera intégrée au service public de la santé pour devenir véritablement indépendante des employeurs et se concentrer sur la prévention. Nous rétablirons la visite périodique annuelle, y compris pour les personnes au chômage, rendrons systématique le suivi post-professionnel au moment de la cessation d’activité et garantirons un suivi des chômeur·ses par la médecine du travail. Le médecin du travail se prononcera sur l’aptitude du poste à recevoir un salarié sans mettre en cause sa santé, et disposera d’un pouvoir d’injonction de l’employeur en cas de risque pour la santé (injonction transmise automatiquement à l’inspection du travail et à la CARSAT). Tous les moyens seront donnés à la justice pour que les procédures pénales et civiles concernant le scandale de l’amiante et du chlordécone aux Antilles puissent aboutir.
Il faut aussi simplifier la procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles qui frappent plus durement les ouvrier·es et les employé·es et assurer une réparation intégrale. En premier lieu, nous prendrons les mesures urgentes suivantes :
- Reconnaître le burn-out et autres syndromes d’épuisement professionnel comme maladie professionnelle
- Intégrer tous les cancérogènes reconnus par le Centre international de recherche sur le cancer dans les facteurs de maladie professionnelle et s’assurer du suivi individuel et territorial des cancers professionnels et environnementaux (au moins 2,7 millions de salarié·es sont exposés à au moins un produit chimique cancérogène)
- Prendre en compte la multi-exposition et les risques émergents : nanomatériaux, perturbateurs endocriniens, amiante…
- Supprimer l’exigence d’incapacité partielle de 25 % (ou de décès) pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux
- Inclure l’ensemble des pathologies liées au Covid-19 dans les tableaux de reconnaissance de maladies professionnelles, pour tou·tes les travailleurs et travailleuses exposé·es quel que soit le secteur d’activité