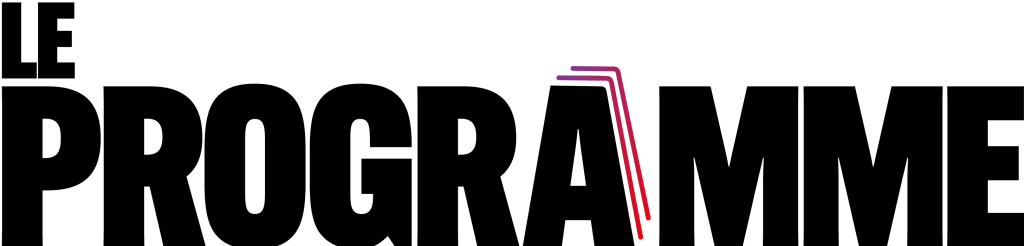Le procès de l’ancien chirurgien Jöel Le Scouarnec s’est ouvert lundi 24 février. Il est accusé de faits de viols et d’agressions sexuelles aggravés sur 299 victimes, presque toutes mineures. Pendant 30 ans, il est parvenu à passer sous les radars. Il a profité du pouvoir que lui conférait sa blouse pour entretenir la confusion entre actes médicaux et violences sexuelles, ainsi que pour soumettre chimiquement ses victimes. Entre 1989 et 2014, il commet ses crimes au gré des affectations : à Lorient (56), Quimperlé (29), Le Mans (72), Nantes (44), Saint-Brieuc (22) ou encore Flers (61).
Pourtant en 2005, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis – sans obligation de soins, ni restriction d’exercice – pour détention d’images pédopornographiques. Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins (CDOM) du Finistère s’était dit incompétent pour le poursuivre devant sa juridiction disciplinaire. L’alerte sur sa condamnation serait alors remontée jusqu’au ministère de la Santé sans que rien ne soit fait.
La justice tranchera. Néanmoins, ce procès questionne plus largement l’impunité et l’omerta qui règnent dans le secteur médical et hospitalier, la responsabilité de l’institution médicale et judiciaire dans la perpétuation des violences et les défaillances de l’État dans la protection des enfants et la lutte contre la pédocriminalité.
#MeTooHôpital : briser la loi du silence
En avril dernier, les témoignages de violences sexistes et sexuelles à l’hôpital se sont multipliés suite aux accusations de harcèlement sexuel et moral à l’encontre de l’urgentiste Patrick Pelloux par l’infectiologue Karine Lacombe. Unies sous le hashtag #MeTooHôpital, les victimes font état d’un climat sexiste banalisé, ciblant particulièrement les étudiantes et soignantes, violentées sur leurs lieux de formation ou de travail.
Cette vague de témoignages démontre le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles dans le milieu hospitalier. Un continuum de violences à la fois psychologiques, physiques et sexuelles, institutionnalisées autour d’une culture « carabine ». L’association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) révèle que 15% des étudiant·es déclarent avoir subi une agression sexuelle au cours de leurs études. Lors de stage, 49,7% des femmes ont reçu des remarques sexistes et 38,7% ont été victimes de harcèlement sexuel. Dans 9 cas sur 10, l’harceleur était un supérieur hiérarchique.
L’enquête de l’Ordre des médecins révèle quant à elle que 65% des médecins actifs déclarent avoir eu connaissance de violences sexistes et sexuelles dans le monde médical. 29% déclarent avoir été victimes, 54% parmi les femmes, en majorité lors de leur parcours étudiant. Ces violences proviennent, dans une proportion significative, de médecins inscrits à l’Ordre : pour environ 90% des victimes, ces violences ont été perpétrées par un autre médecin.
La consultation lancée par l’Ordre National des Infirmiers aboutit aux mêmes conclusions : une infirmière sur deux, dans le public comme dans le libéral, a été victime de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de son exercice. Les infirmières exerçant à l’hôpital sont plus exposées aux violences provenant d’autres professionnels de santé (57% contre 47% en moyenne) et de leurs collègues infirmiers (18% contre 15%), que les infirmières libérales.
A l’origine de l’omerta : les inégalités femmes-hommes, la hiérarchie et l’entre-soi
L’organisation très hiérarchique de l’hôpital et la surreprésentation des hommes aux postes à responsabilité jouent un rôle dans la perpétuation des violences. Le constat est alarmant : des professionnels de santé profitent de leur position de figure d’autorité pour violenter à la fois des patient·es et des collègues sur leur lieu de travail. Pour celles et ceux qui brisent le silence, c’est la double peine. Les victimes ont peur des représailles et des risques qui pèsent sur leur carrière. Les internes ont peur de ne pas valider leur stage, voire d’être blacklisté·es. Et lorsque les victimes parlent, les signalements sont rarement suivis d’effets. Peu de procédures disciplinaires aboutissent véritablement. Les supérieurs hiérarchiques, maîtres de stage et chefs de services profitent alors de cette omerta pour violenter en toute impunité.
De même, les patientes se trouvent désarmées pour dénoncer les violences sexuelles subies et parmi elles, les violences obstétricales et gynécologiques. Les violences sont minimisées et les médecins protégés. Par exemple, le gynécologue Émile Daraï continue d’exercer à l’hôpital Tenon malgré 32 mises en examen pour violences volontaires depuis 2022. Et alors que le ministère de la Santé a sorti en janvier un plan d’action de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en santé, la question des violences commises sur les patient·es y est complètement absente.
Casse du service public de la santé : les politiques gouvernementales renforcent les inégalités
Quatre femmes ont témoigné à l’AFP des agressions dont elles ont été victimes. Parmi elles, une infirmière en poste en maternité s’est vue répondre : « il nous manque des médecins, ce sera ta parole contre la sienne ». Mêmes réactions dans d’autres hôpitaux et services où les directions agitent la menace de la fermeture pour silencier les victimes. Ces réactions ne sont pas anodines : selon Oxfam, l’austérité est une forme de violence économique qui a des effets genrés et précarise l’emploi des femmes.
Les déserts médicaux, les coupes budgétaires successives du gouvernement et sa politique de détérioration des services publics sont autant de facteurs qui dégradent les conditions de travail, augmentent les risques psychosociaux à l’hôpital et exposent davantage encore les femmes aux violences. Un phénomène d’autant plus marqué qu’elles représentent 77% de la fonction publique hospitalière, sont payées en moyenne 22% de moins que les hommes et sont surreprésentées dans les métiers du care dévalorisés ainsi que dans les services subissant de plein fouet la casse du gouvernement (maternité, pédiatrie, etc.).
Nos propositions
- Améliorer l’accès à la santé des femmes et leur prise en charge, reconnaître et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques
- Appliquer pleinement la Convention 190 contre la violence et le harcèlement au travail de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ratifiée par la France en avril 2023
- Revaloriser en matière de salaires, de conditions de travail et de parcours professionnels les métiers occupés majoritairement par des femmes dans les secteurs du soin et du lien
- Engager un plan de formation massif des professionnel·les de santé et plus largement assurer une formation spécifique et obligatoire en matière de violences sexistes et sexuelles pour tou·tes les professionnel·les concerné·es (santé, police, justice, éducation nationale, services sociaux, etc.)
- Combattre les déserts médicaux (recrutement de médecins publics, financement de l’augmentation du nombre de places en faculté de médecine en partant des besoins, création d’un réseau public de centres de santé pluridisciplinaires ou communautaires et de coopératives médicales, etc.)
- Allouer les 2,6 milliards d’euros de budget demandé par les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
Retrouvez toutes nos propositions dans le livret thématique égalité femmes-hommes de l’Avenir en Commun : https://programme.lafranceinsoumise.fr/livrets/egalite-femmes-hommes/